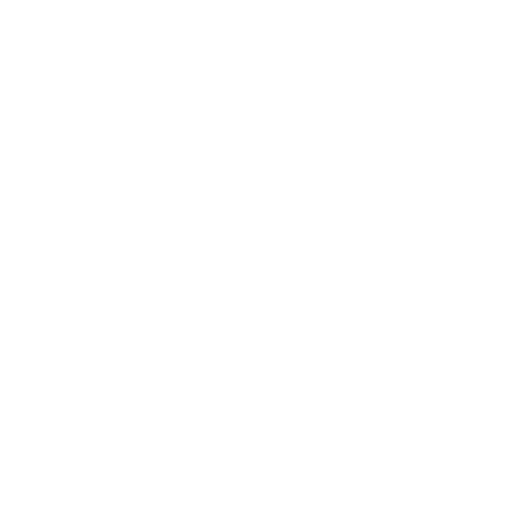La CEDH a condamné la France, jeudi 23 avril dernier, pour entrave à la liberté d'expression d'Olivier Morice, avocat d'Elisabeth Borrel, veuve du juge français retrouvé mort à Djibouti en 1995. L'affaire, qui empoisonne les relations de la France avec son ex-colonie depuis 20 ans, n'est toujours pas résolue.
La sentence n'est susceptible d'aucun recours : la France vient d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) pour entrave à la liberté d'expression d'un des avocats d'Elisabeth Borrel, veuve du juge français Bernard Borrel, retrouvé mort à Djibouti le 19 octobre 1995. Maitre Olivier Morice, d'après les juges européens, s'est ainsi « exprimé par des jugements de valeur reposant sur un base factuelle suffisante. Ses propos n'ont pas dépassé les limites du droit », tandis qu'il reprochait, dans un article publié dans le Monde en 2000, à la juge d'instruction chargé du dossier Borrel entre 1997 et 2000, Marie-Paule Moracchini, sa« connivence » avec la justice djiboutienne.
« Le juge fouineur est mort » aurait-on rapporté à Ismaël Omar Guelleh
Des propos diffamatoires, selon la France, qui avaient valu à Maitre Morice d'être condamné en 2008 par la justice hexagonale à 4 000 euros d'amende. Condamnation de facto annulée par la CEDH qui, si elle a reconnu qu' « un avocat ne saurait être assimilé à un journaliste » et bénéficier à ce titre de la même liberté de parole, a estimé que les propos incriminés intégraient le champ du « débat d'intérêt général » sur les dysfonctionnements de la justice. D'où une protection de sa liberté d'expression plus importante qu'en temps normal – même si les juges européens ont tenu à circonscrire la portée de leur arrêt, motivé par « la grande importance du contexte de cette affaire ».
Bernard Nicolas, journaliste et coauteur, avec Elisabeth Borrel, d'Un juge assassiné (1), la réduit ainsi, ni plus ni moins, à « une ingérence de la diplomatie sur la justice ». Bernard Borrel, procureur de Lisieux de 1988 à 1995, est détaché en tant que conseiller technique en avril 1994 auprès du ministre djiboutien de la Justice, pour effectuer des missions de coopération. Lorsque son corps est retrouvé dans un ravin, à moitié calciné, le 19 octobre 1995, la thèse du suicide prévaut ; l'ambassade de France, sans attendre les résultats de l'autopsie, annonce au Quai d'Orsay le « suicide du juge Borrel ». Mais, tandis que les justices française et djiboutienne, ainsi que la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), avalisent toutes cette thèse, le témoignage d'un ex-membre de la garde présidentielle de Djibouti, Mohamed Saleh Alhoumekani, vient ébranler l'instruction en cours. Le jour de la mort du juge, ce dernier affirme avoir entendu cinq hommes déclarer à l'actuel président de la République djiboutienne, Ismaël Omar Guelleh, alors directeur de cabinet de son prédécesseur, que « le juge fouineur est mort et il n'y a pas de trace ».
« Mon mari pensait qu'Omar Guelleh était le commanditaire » (Elisabeth Borrel)
En novembre 1999, l'instruction pour le chef d'assassinat est confiée à Marie-Paule Moracchini, par la suite associée à Roger Le Loire. Après une saisine de la Brigade criminelle et des déplacements sur place, dans le cadre de commissions rogatoires internationales, ils concluent au suicide. Seulement, les révélations sur la possible implication d'Ismaël Omar Guelleh dans la mort du juge Borrel incitent sa femme et plusieurs syndicats de la magistrature à demander une contre-expertise… qui leur sera refusée par le duo Moracchini/Le Loire. Levée de bouclier dans le camp d'Elisabeth Borrel ; son avocat, Maitre Morice, accuse la magistrate Moracchini d'entretenir d'ambivalentes relations avec les autorités djiboutiennes. Elle est finalement dessaisie du dossier. Celle qui prend sa succession, Sophie Clément, essaye en vain d'auditionner Ismaël Omar Guelleh à plusieurs reprises. La veuve du juge Borrel, quant à elle, est certaine de son implication : « Mon mari pensait qu'il était le commanditaire » assène-t-elle à plusieurs reprises.
L'étau se resserre peut-être autour de l'actuel président de la République de Djibouti. Les pressions dont le témoin Mohamed Saleh Alhoumekani s’est dit victime début 2014 de la part des autorités djiboutiennes vont en tout cas dans ce sens. Le 27 juin 2007, un second témoignage vient appuyer un peu plus la thèse de sa participation au meurtre de Bernard Borrel. La juge d'instruction Sophie Clément apprend d'un ex-membre du renseignement militaire français que « le ministre djiboutien de la Justice, Moumin Badon Farah, avait chargé M. Borrel de constituer un dossier sur l'ensemble des trafics auxquels Ismaël Omar Guelleh était mêlé ». A l'époque, au milieu des années 1990, l'ancienne colonie française est en proie à des luttes de pouvoir pour accéder à la présidence ; le juge Borrel devait rassembler assez de preuves pour écarter Omar Guelleh du poste suprême. Une tâche qui, selon de plus en plus de protagonistes dans le dossier, pourrait l’avoir tué.
Après que la justice française, en 2007, a finalement reconnu l'origine criminelle de la mort de Bernard Borrel, son dernier acte, à ce jour, est la demande, en mars 2014, de la déclassification de documents auprès des ministères français de la Défense et de l'Intérieur. La France est ainsi régulièrement accusée de complaisance à l'égard de son ancienne colonie, tandis que leurs relations sont presque au point mort depuis vingt ans. Djibouti, pourtant, de part sa position éminemment stratégique, joue un rôle majeur dans la lutte contre le djihadisme au Moyen-Orient. De quoi légitimer, malheureusement, les soupçons d' « ingérence de la diplomatie sur la justice ».