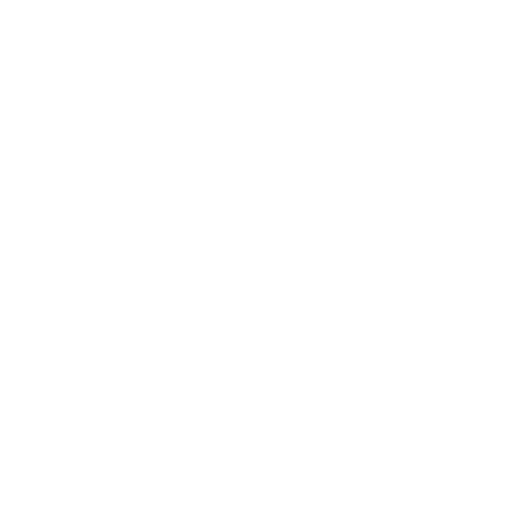Le 14 octobre 2020, un accord relatif à l’encouragement et à la protection réciproques des investissements entre la France et la Colombie est entré en vigueur. Cet accord fournit un « cadre juridique stable, clair et prévisible aux investissements français en Colombie et aux investissements colombiens en France ». Les investissements étrangers sont en effet encadrés par un ensemble de garanties juridiques qui permet aux investisseurs de sécuriser leurs opérations à l’étranger et de se prémunir de l’arbitraire des Etats, notamment en cas d’expropriation. Pourtant, malgré l’existence d’un réseau français d’accords sur la promotion et la protection des investissements, et d’un mécanisme international de règlement des différends entre investisseurs et Etats, l’histoire récente montre que la protection des investisseurs peut n’être pas toujours garantie. Le cas de l’Argentine, notamment dans l’affaire SAUR v. Argentine, illustre les difficultés qui existent autour de la protection des investissements.
Une affaire qui témoigne de la vulnérabilité des investisseurs étrangers face à l’arbitraire des Etats
L’affaire SAUR International v. République Argentine date de 2004, et tire son origine de la difficile situation économique et financière de l’Argentine au début des années 2000. L’abandon de la parité peso-dollar, conséquence directe de la loi du 6 janvier 2002 sur l’urgence économique, a provoqué une profonde dévaluation de la monnaie argentine. Les concessions chargées de la gestion de l’eau, privatisées dans les années 1990, sont alors devenues peu rentables. Ces mesures d’urgence, destinées à faire face à la crise, ont fait l’objet de nombreux recours devant des tribunaux d’arbitrage comme le CIRDI (Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements). Le Monde Diplomatique le rappelait ainsi en 2014 : « Les mesures prises par Buenos Aires pour faire face à la crise de 2001 (contrôle des prix, limitation de sortie des capitaux…) ont été systématiquement dénoncées devant les cours d’arbitrage. ». La SAUR a ainsi poursuivi la province de Mendoza, au motif que le gel du prix de l’eau portait atteinte à la valeur de son investissement. Après une demande d’arbitrage introduite par la SAUR le 17 novembre 2003, qui chiffrait à 143 millions de dollars l’indemnisation demandée en réparation du préjudice causé à son investissement, le tribunal d’arbitrage a « fait droit à la quasi-totalité des prétentions » de la SAUR et a conclu en 2014 que l’indemnisation du préjudice s’élevait à 40 millions de dollars. L’Argentine a ensuite déposé une demande en annulation, mais le comité ad hoc du CIRDI chargé de statuer a rejeté cette demande en 2016. Cinq ans après, l’Argentine n’a toujours pas payé l’indemnisation chargée de réparer le préjudice causé aux investissements de la SAUR dans les années 1990.
L’affaire SAUR v. Argentine n’est pas un cas isolé, et doit être replacée dans le contexte plus global des mesures prises par l’Argentine au début des années 2000 pour lutter contre la crise économique. Un rapport d’information de la commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale, consacré au règlement des différends Investisseurs États dans les accords internationaux (RDIE) notait ainsi en 2016 : « L’Argentine est, quant à elle, le pays qui a fait l’objet du plus grand nombre de plaintes d’investisseurs étrangers via la mise en œuvre du RDIE. Au début des années 90, ce pays a privatisé ses entreprises publiques tout en s’ouvrant largement à l’investissement étranger. (…) Or, après une décennie de politique ultralibérale, le pays a été frappé par une grave crise financière qui culmina avec la loi d’urgence économique du 6 janvier 2002 (…). Au total, 37 plaintes ont été déposées à la suite de ladite loi, portant le total des différends impliquant l’Argentine à 53. ». Ce rapport livre par ailleurs un éclairage intéressant sur le comportement de l’Argentine face à ces différends. Celle-ci pratique en effet « le refus de payer pour forcer les investisseurs à accepter une réduction de leur compensation. » L’Argentine « non seulement demande systématiquement la nullité des sentences arbitrales prononcées à son encontre » (comme dans l’affaire SAUR), mais elle « refuse de les exécuter en cas de rejet de son recours ».
La volonté de l’Argentine de ne pas payer la SAUR fragilise le mode de règlements des différends entre investisseurs et États
Au-delà de la volonté de l’Argentine de ne pas payer les sommes destinées à compenser le préjudice subi par les investisseurs, ce comportement témoigne du rejet d’un mode de résolution des conflits entre investisseurs et États s’appuyant sur l’arbitrage et le droit international. En ne donnant pas suite aux décisions du CIRDI, l’Argentine refuse le mécanisme de Règlement des Différends entre Investisseurs et États (RDIE), prévu par des Traités Bilatéraux d’Investissements (TBI). Or le RDIE « repose sur le consentement des États à voir leurs différends avec les investisseurs réglés par l’arbitrage », rappelle le rapport de l’Assemblée nationale précédemment cité. Dans le cas de l’affaire SAUR v. Argentine, le RDIE s’appuie sur l’accord bilatéral de protection des investissements conclus entre la France et l’Argentine le 3 mars 1993. Les États étant souverains, et maîtres de leurs traités, l’Argentine affirme son consentement au RDIE prévu par ce traité de protection des investissements. En cas de désaccord, il est toujours possible de dénoncer un traité. C’est par exemple ce qu’a fait la Bolivie, en dénonçant en 2013 le traité bilatéral de protection des investissements qui la liait à la France.
Si les traités bilatéraux portant sur les investissements ne prévoient pas le mécanisme d’arbitrage qui réglera le différend, l’instance la plus importante demeure le CIRDI. Celui-ci repose directement sur le consentement des États et sur le droit international : il a été créé en 1965 par la Convention de Washington, traité ratifié par 154 États contractants. La notion de consentement à l’arbitrage est même considérée par certains commentateurs de la convention comme « la pierre angulaire » du CIRDI. Dès lors, en ne respectant pas les conclusions de l’arbitrage, l’Argentine vient fragiliser un système international de résolution des différends. L’article 54 de la convention de Washington dispose en effet que « chaque État contractant reconnaît toute sentence rendue dans le cadre de la présente Convention comme obligatoire et assure l’exécution sur son territoire des obligations pécuniaires que la sentence impose comme s’il s’agissait d’un jugement définitif d’un tribunal fonctionnant sur le territoire dudit État ».
Le refus politique d’un mécanisme de résolution des différends pourtant nécessaire
Au-delà de l’exemple emblématique de l’affaire SAUR v. Argentine, le refus de payer de l’Argentine fragilise le règlement des différends entre États et investisseurs, pourtant important dans les relations entre pays développés et pays en développement. Une note de l’Institut Économique Molinari intitulée « Le règlement des différends entre investisseurs et Etats : entre mythes et réalité » rappelle que « Le RDIE et son inclusion dans les TBI a démarré dans les années 1950, alors que les anciennes colonies nouvellement indépendantes ont cherché à rassurer les investisseurs étrangers qu’ils seraient protégés et adéquatement compensés en cas d’expropriation. »
Certains font par ailleurs état de la faiblesse congénitale de l’investisseur face à la puissance étatique : C. Leben, dans « Théorie du contrat d’État et évolution du droit international des investissements », note que le RDIE viendrait « corriger les défauts de la protection diplomatique : l’investisseur n’est plus obligé d’épuiser les voies de recours internes, il ne dépend plus du bon vouloir de son État national pour faire régler le litige, et c’est bien son litige avec son État d’accueil qui va être porté devant les arbitres ».
Si les intérêts des investisseurs trouvent une garantie dans l’existence de tels mécanismes de règlement des conflits, les RDIE cherchent aussi à garantir les intérêts des populations. En particulier dans les affaires comme SAUR v. Argentine mettant en jeu des enjeux de service public comme l’eau. Pour cette affaire comme pour d’autres, la question des investissements étrangers est difficilement dissociable de celle de la sécurité alimentaire des populations. Dans sa thèse intitulée La sécurité alimentaire à l’épreuve du droit international des investissements, Emily Madeleine écrit : « si l’alimentation ne devrait pas dépendre du système de libre-échange, il n’en reste pas moins qu’elle fait partie intégrante des échanges commerciaux. Dans ce sens, la stabilité alimentaire est liée à la stabilité économique. Dès lors, porter atteinte à la protection des investissements conduit aussi, dans certaines hypothèses à fragiliser la sécurité alimentaire ». Le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États peut donc avoir un rôle à jouer dans la garantie de cette sécurité alimentaire.
Pourquoi, dès lors, un tel refus de payer de la part de l’Argentine ? De nombreuses critiques pèsent sur le RDIE, qui bénéficierait uniquement aux intérêts des investisseurs et viendrait porter atteinte à la souveraineté des États. On a vu que c’était pourtant cette même souveraineté qui prévalait dans le consentement au RDIE. Pour le reste, fin 2013, « 43 % des 274 affaires résolues à l’échelle internationale ont été favorables à l’État, 31 % à l’investisseur, et dans 26 % des cas, il y a eu une négociation à l’amiable » rappelait l’Institut Molinari. Quant à une supposée inflation des litiges entre États et investisseurs, elle doit être mise en balance avec la croissance conjointe des investissements à l’étranger ces deux dernières décennies. Si le mécanisme de RDIE demeure donc si mal aimé, c’est peut-être d’abord parce qu’il est mal connu.